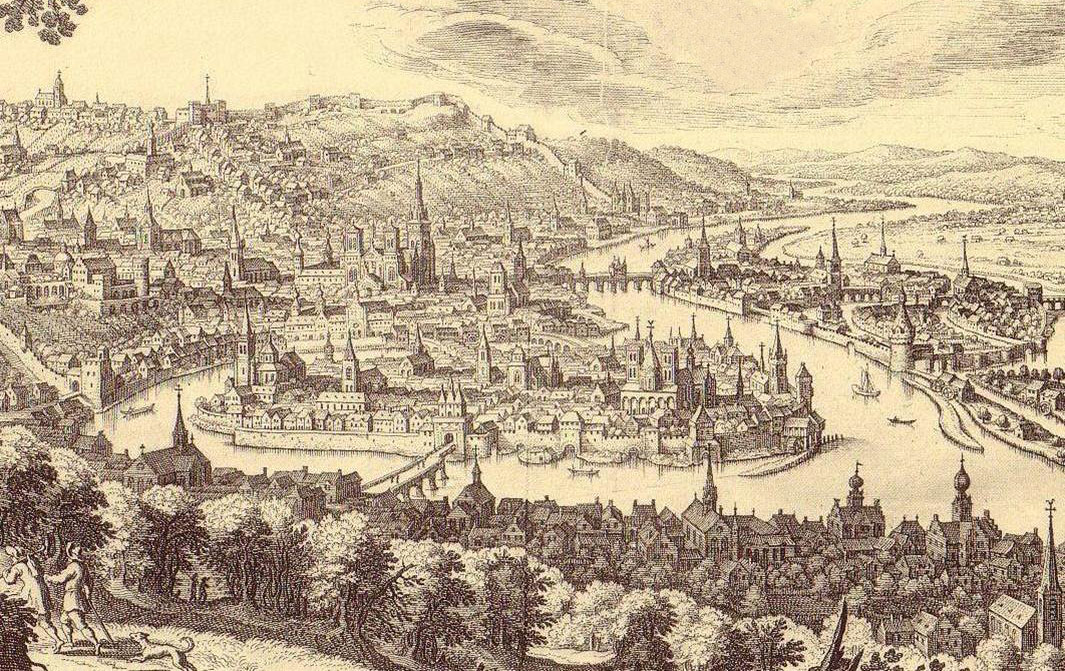l’odeur des villes au XXè s
Londres, vers 1900
Le métropolitain, ce tunnel embué de vapeur et qui sentait le soufre.
[...] Les rues étaient pleine de chevaux. Les rues étaient jonchées de petits tas marron fumants: crottin de cheval que des gamins, jaillissant entre les roues, ramassaient à la pelle.
[...] Les rues étaient ébranlées par le pas des chevaux, elles sentaient le cheval.
(Virginia Woolf, in: "Voyager avec Virginia Woolf, promenades européennes", La Quinzaine Littéraire . Louis Vuitton, 1994, pp. 30, 31)
Marseille – vers 1900
Je crois être ailleurs et c'est Gênes qui me vient à l'esprit. Ces ruelles fraîches, ou se mêlent les cris des marins au son des accordéons, ces ruelles qui ne laissent percevoir qu'une frange de lumière bleue, un peu comme un canal céleste, et qui, plus que des voies publiques, semblent des couloirs entre des maisons très anciennes, ces ruelles qui sentent l'ail, le miel et le jasmin sont italiennes. Et italiens aussi ces visages pâles, dans lesquels brillent des yeux qu'habitent la volonté et l'ambition.
(Enrique Gomez Carrillo: "De Marsella a Tokio, Sensaciones et Egipto, la India, la China y el Japon", Garnier Hermanos, Paris, 1900, trad. Jean M. Goulemont, cité dans Jean M. Goulemot, Paul Lidsky et Didier Masseau, "Le voyage en France – anthologie des voyageurs européens en France, aux XIXè et XXè siècles", Robert Laffont, coll. Bouquins, Paris, 1997, p. 285)
Bruxelles, 1901
Je me rappelle;.. bien sûr, je me rappelle Bruxelles. C'est la première ville que j'ai connue. Rues grises. Ciel gris. Les pavés gris d'une pierre dure. Une odeur de cuisine, de bois ciré, de lavage.
John DOS PASSOS, Fragments d'une enfance bruxelloise, 1966.
Berlin – 1906
L'abondance des brasseries est importante. A Berlin plus encore qu'ailleurs, elles se bousculent les unes les autres de leurs façades orgueilleuses; toutes sombres, naturellement, comme il sied à leur style gothique, mais chaudes et hospitalières l'hiver, et empuanties, en tout temps, par une odeur fade de charcuterie et de cigare éteint.
(Jules Huret, "En Allemagne – Rhin et Westphalie", Eugène Fasquelle, Paris, 1919, p. 13)
Francfort - Palmengarten - 1906
il y a là [dans les jardins d'hiver du duc de Nassau ] un Palmengarten comme il n'en n'existe nulle part, ou du moins comme je n'en ai jamais vu. Des palmiers, des caoutchoucs, des poivriers, des bananiers, des camphriers, des cocotiers merveilleux, tous les arbres exotiques, les fleurs les belles des pays chauds : magnolias, azalées, rhododendrons, camélias, orchidées, et des roses, et des muguets, y sont réunis sous des coupoles de verre; on marche entre des haies de verdures parfumées qui sont des allées de paradis pour qui aime les fleurs et les feuilles vivantes. Des ruisselets courent entre les bandes de gazon, il y fait doux l'hiver, on y est au frais l'été.
(Jules Huret, "En Allemagne – Rhin et Westphalie", Eugène Fasquelle, Paris, 1919, p. 53)
Essen - 1906
C'est une ville de briques noires, de poussière et de fumée. Le ciel y est toujours d'un gris sale et menaçant. Il y pleut souvent. Qu'on mette le nez à la fenêtre, qu'on se promène à travers la ville, la même odeur de houille vous poursuit, et la même perspective de cheminées fumantes vous entoure. La moitié de la ville est occupée par les usines Krupp. Aussi de côté, à travers les rues, d'un mur à l'autre, d'énormes conduites de fonte, reliant les ateliers, barrent l'horizon à la hauteur du deuxième étage. Ces cheminées verticales, ces tuyaux horizontaux, voilà ce que le regard rencontre pour se distraire des façades noires et du ciel triste.
(Jules Huret, "En Allemagne – Rhin et Westphalie", Eugène Fasquelle, Paris, 1919, pp. 325-326)
Hanovre - 1906
La ville est vraiment double. D'un côté, la partie moderne et commerçante, aux voies larges comme la Georgstrasse, traversées de nombreux tramways rapides qui égayent de leur timbre les allées et venues des passants taciturnes et la froideur des rues admirablement nettes et propres, la gare monumentale, la place du Théâtre à la façade ornée de statues devant lesquelles il est inutile de s'arrêter; le café Kröpcke, situé dans un pavillon entouré des verdures de la place, centre du mouvement et des élégance jolis magasins, le nouveau Rathaus, à peine achevé, qui égalera par sa splendeur ceux des plus riches cités allemandes, les jardins publics et les vastes parcs, donnent à cette partie de la ville l'aspect d'une capitale un peu morose.
D'autre part, la vieille capitale guelfe a ses antiques maisons endormies au bord d'une rivière boueuse, la Leine, les unes, droites encore avec leur quatre étages surmontés d'un pignon, leurs façades grises dont les fenêtres, si petites qu'un pot de géranium suffit à les cacher, s'ouvrent à l'extérieur, égayées de minuscules vitres éblouissantes au soleil comme autant de miroirs; les autres, si branlantes et décrépites qu'on dirait de toutes petites vieilles ratatinées, courbées et chancelantes malgré leurs bâtons. Des rues étroites, des ponts de bois sur l'eau, les tours de l'ancienne maréchaussée, des places entourées de maisons dont les murs s'inclinent à leur fantaisie et d'apparence si antique qu'on a surmonté l'une d'elles, de forme allongée et dont la toiture est à deux pentes, "L'Arche de Noé". […] Suivant les quais, s'engageant dans le Klostergang, petit boyau bordé de maisons sordides, pavé de dalles larges, où trois hommes ne pourraient passer de front, il flotte dans ces allées étroites et humides l'odeur fade et aigre des vieilles rues allemandes, mélange de friture refroidie, de choux cuits et de cigare éteint.
(Jules Huret, "En Allemagne – Rhin et Westphalie", Eugène Fasquelle, Paris, 1919, pp. 460-461)
Goettingue - 1906
La vie principale, Weenderstrasse, est longue et bordée de magasins modernes alternant avec de vieilles maisons basses. Vous voyez cela d'ici: la rue de province où les étudiants se promènent en maîtres. […] Ils laissent derrière eux l'odeur écoeurante de l'iodoforme qu'on retrouve partout, dans les maisons, les salles de cours, les pâtisseries, les hôtels, et même les forêts environnantes.
[…] La Maria Spring est un autre endroit de rendez-vous de la jeunesse de Goettingue, situé à l'orée d'une forêt voisine. Au centre d'un cercle de verdure, une estrade s'élève, un orchestre joue des airs de danse. En contre-bas et tout autour, sur des pentes où l'on accède par des escaliers rustiques, des tables sont dressées, garnies de buveurs. Je me promène un instant dans la foule des étudiants. […] Une odeur d'iodoforme circule sous les arbres. Ce relent d'hôpital dans la forêt printanière est répugnant; il vient des pansements que portent les blessés des derniers duels sur leurs têtes enveloppées de calottes noires, la face zébrée de bandes de taffetas bleuâtre. Je monte au sommet des gradins aménagés sous les arbres. L'affreuse senteur m'y poursuit. Subtile, elle se répand et reste suspendue dans l'air, sous les feuilles de chênes et des ormes. [iodoforme: composé (CHI3), que l'on obtient en faisant agir l'iode sur l'alcool, et employé surtout comme antiseptique (Larousse)]
(Jules Huret, "En Allemagne – Rhin et Westphalie", Eugène Fasquelle, Paris, 1919, pp. 409-410 et 412-413)
Venise – 1908
(près de la gare) l’eau de ces Fundamenta Santa Lucia ou dei Turchi y pue moins qu’ailleurs ; battue par les hélices, elle y reprend de l’oxygène et ne dégage pas d’hydrogène sulfureux.
[…] du canal montait l’odeur d’eau pourrie de ces vases dont on a oublié de retirer les bouquets fanés.
(Paul Morand, "Venises", Gallimard et Librairie Jules Tallandier - Cercle du Nouveau Livre, Paris, 1971, pp. 45 et 47.)
Milan - galerie Victor Emmanuel - 1909
La Galerie de Milan [...] ouvre une bouche énorme sur la place du Dôme, [...] jour et nuit, la gueule de la Galerie crache et aspire le flot des passants. [...] Elle grouille de peuple, à toute heure. Il y règne un luxe épais. La Galerie est pleine de magasins, de boutiques, de cafés. Les pas des promeneurs, le talon de ceux qui se hâtent, la voix de ceux qui demeurent, les appels, le cliquetis des verres et des cuillères dans les tasses, tous ces rayons sonores engendrent une sphère de bruit, où l’on reste assourdi. Un peu partout les échos retentissent. Le luxe vulgaire de la Galerie répond au faste de la façade: la pierre de taille est sale; les membres de l’édifice semblent de vieux papier. Sous le berceau des vitres, il fait une chaleur de serre. La lumière est aussi laide, aussi crue, que dans un atelier de chimiste. Par temps de pluie, rien de faux et de pesant comme ce jour lugubre, qui traîne en linge gris. Mais l’odeur, surtout, est à donner le frisson: l’air humide sent le chien crevé, les socques, le caoutchouc, le poil, le cadavre et la chique. dans la saison chaude, la poussière pétille: les atomes dansent dans le soleil; chaque grain a son poivre qui se mêle à la puanteur profonde des chambres correctionnelles, au remugle de la fiente humaine, à la note écoeurante des mauvais savons et aux nuages du tabac noir percé d’une paille.
(André Suarès, “Le voyage du Condottière,I, vers Venise”, Granit, Poche biblio, n°3259, Paris, 1984, pp. 40-41.)
Munich - une brasserie – vers 1910
Si l’on veut prendre contact avec les vrais buveurs de bière, il faut se rendre à la Hofbräuhaus (brasserie de la Cour). Elle se trouve au centre de la ville, au Platzl, à deux pas de la Maximilianstrasse. On entre dans une sorte de cour plantée d’arbres, avec une fontaine au milieu, et où des tonneaux se dressent, sur lesquels de grands bocks de grès au couvercle d’étain sont posés. Autour de ces tonneaux, des hommes debout fument la pipe en devisant. De cette cour on pénètre de plain-pied dans la brasserie qui a l’air d’un cloître, avec ses arcades en ogives appuyées sur des piliers trapus et des murs peints de fresques pâles. [...]Une affreuse odeur de bière et de tabac emplit les salles. Le long de massives tables de chêne, assis sur des bancs grossiers, des centaines de buveurs, les uns à côté des autres, fument de longues pipes ou des cigares.
(Ju Jules Huret, “En Allemagne: la Bavière et la Saxe”, Eugène Fasquelle, Paris, 1916, pp. 42-43.)
Les théâtres – Allemagne et France – vers 1910
Partout en Allemagne, les théâtres sont très propres, d’une propreté de salon. On n’y respire pas cette affreuse odeur de poussière et de renfermé des salles de chez nous, en général si négligées.
(Jules Huret, “En Allemagne: la Bavière et la Saxe”, Eugène Fasquelle, Paris, 1916, pp. 230-231.)
L’usine de crayons Faber – Nuremberg – vers 1910
La fabrique Faber compte 1000 ouvriers. La réserve de bois se trouve dans la cour, sous un vaste hangar surmonté de six paratonnerres ; là sèchent des montagnes de poutres de cèdre, de tilleuls entiers, des bouleaux de Suède et des tas de petites planchettes qui furent sciées sur le lieu d’abatage. Une odeur exquise, balsamique, émane de ces bois de cèdre ; on respire partout la poussière parfumée qui s’échappe des scies mécaniques. Tous les bâtiments sont couverts de cette cendre rouge. Rien que de poussière de cèdre, la maison recueille dans ses ateliers près de 15.000 kilogrammes chaque année, revendus aux fabricants d’huiles éthériques, aux parfumeurs qui en tirent, par le mélange, des parfums variés.
(Jules Huret, “En Allemagne: la Bavière et la Saxe”, Eugène Fasquelle, Paris, 1916, p. 208.)
Taormina – 1911
Arrivé de nuit, j’ai ouvert ma fenêtre, le premier matin, sur le paradis. Devant le balcon où je m’appuie, toutes les parures de Cérès sont étalées. Que de couronnes pour les longues chevelures ! Que de subtiles odeurs à capter dans les lécythes ! L’Etna tout blanc de neige est sous mes yeux, lançant sa fumée paisible et menaçante ; à ma gauche, l’Aspromonte se profile au-dessus de la côte calabraise : les hommes sont bien fous qui, ce printemps, se sont privés de venir ici par peur du volcan et des tremblements. La joie de respirer ces parfums et de regarder ces beautés vaut bien la petite angoisse qu’on pourrait éprouver.
(André Maurel, "Petites villes d’Italie", Librairie Hachette et Cie, Paris, 1911, pp. 56-57)
Palerme – 1911
Les alentours du musée, de San Francesco, de San Domenico, […] c’est la vieille ville italienne, plus généreuse que sur le continent. Elle fournit abondamment à tous les goûts de couleur, de moeurs imprévues, de costumes, de vie innocente et lâchée, victuailles au milieu et de la chaussée et croulant dans le ruisseau, légumes et poissons, fruits et pâtes poussiéreuses mêlés, se chevauchant sur le trottoir comme dans l’estomac. Les pas doivent être précautionneux et les yeux attentifs. Leur nez, d’ailleurs avertit les myopes. Longues, étroites, mais du moins nettes, étincelantes même, très modernes enfin, le Corso et Maqueda offrent à respirer un air sans parfums, à regarder des maisons sans loques et dont on ne voit pas l’égout – si on le sent toujours.
Le quartier neuf n’a pas de couleur, comme on dit. Mais en revanche, il sent bon. Ce n’est que villas sur larges boulevards, hôtels somptueux au milieu de jardins magnifiques, plein de verdures les moins familières, arbres exotiques, plantes aux gestes désordonnés, brandissant des fleurs avec une sorte d’allégresse, d’exaspération frénétique.
(André Maurel, "Petites villes d’Italie", Librairie Hachette et Cie, Paris, 1911, p. 163)
Paris - rue Pierre-au-Lard (aujourd’hui démolie) quartier Beaubourg - vers 1912
Bâtie de guingois, la rue Pierre-au-Lard - qui date de XIIIè siècle et joint par une sorte de demi-cercle la rue Brise-Miche à la rue Saint-Merri - offre ce spectacle: grands murs fleuronnés de moisissures, coupés de fenêtres, aux vitres pour la plupart brisées. Masures sombres, hôtels meublés, gîtes effroyables à “six sous la nuit”. Par-ci, par-là, entre deux barres de fer, émerge un piston qui, par moments, crache des jets de vapeur bleue ou soufrée, remplissant la rue d’une âcre fumée, et dans les caves, entrevues au travers de soupiraux grillagés, hoquettent des machines à vapeur ...
Lorsque les portes cochères massives s’ouvrent en grinçant, l’oeil plonge sur des cours mal pavées, puantes, servant de remise à ces éventaires loués chaque jour aux marchants des quatre-saisons et les voiturettes, renversées sur leurs quilles, tendent en l’air leurs longs bras de bois polis par l’usage comme pour attester le ciel de la misère de ce pauvre quartier.
(Georges Cain, (ancien Conservateur du musée Carnavalet), “Le long des Rues”, Flammarion, Paris, circa 1912, pp. 64-69.)
Liège - Grands magasins– vers 1912
Des grands magasins, il y en avait trois place Saint-Lambert. Le grand bazar, le plus vaste, avec trois ou quatre étages de galeries, où l’on vendait de tout, depuis les crayons et les cahiers d’écoliers jusqu’aux bicyclettes, aux outils, que sais-je encore, de tout sauf des vêtements et du tissu. Son voisin, un autre très grand magasin, Vaxelaire-Claes, était spécialisé, lui, dans la confection, mais dans une confection soignée qui correspondait à ce qu’on appelle aujourd’hui le prêt-à-porter. Enfin, venait l’Innovation.
Les deux premiers magasins cités étaient brillamment éclairés et bruyants. L’Innovation, au contraire, de proportions un peu plus modestes, semblait vouloir garder un éclairage plus intime, une sorte de pénombre dans laquelle on marchait à pas feutrés, on parlait presque à voix basse en circulant dans les rayons, et les inspecteurs, plantés à certains points stratégiques, étaient des messieurs dignes qui portaient encore la redingote et les moustaches cirées. L’odeur y était caractéristique. A l’Innovation, on vendait surtout ce qu’on appelle du blanc, du tissu pour les draps de lit, pour le linge de corps, des vêtements d’enfants brodés ou ornés de dentelles, et il s’en dégageait une odeur sourde si caractéristique qu’il me semble encore la sentir tout en dictant ces lignes. Les pièces de tissu, que l’on déroulait devant les clientes sur de longs comptoirs de bois verni, avaient des noms qui ne doivent plus exister aujourd’hui : madapolam, croisé, pur fil, pur lin, et enfin, tout en bas de l’échelle, le coton qui était alors une matière considérée comme vulgaire tandis que les soies, surtout le liberty, tenaient le haut de l’échelle.
(Georges Simenon, (72 ans en 1975), “Mes dictées : vent du nord, vent du sud”, Presses de la cité, coll. omnibus, Paris, 1993, pp. 893-894.)
Paris – Pantin 1913
Je me revois pénétrant pour la première fois chez Paul Valéry, au 40 de la rue de Villejust, dont je me doutais si peu qu'elle échangerait un jour son nom contre le sien. […] J'ai souvenir qu'il m'avait fort décontenancé, dès l'abord, en me vantant la chance que j'avais d'habiter alors Pantin qui se réduisait pour lui aux usines de parfums de la rue de Paris: il 'enviait, disait-il, ainsi "parmi les jupons de cocotes".
(André Breton, "Entretiens" (extrait d'émissions de la Radiodiffusion Française, mars 1952), NRF, coll. Le point du jour, Paris, 1953, pp. 16-17. )
Liège - maisons – vers 1914 et 1975
Hier, je me laissais aller à évoquer ceux des souvenirs d’enfance qui nous poursuivent plus ou moins toute notre vie [...] J’oubliais une autre sensation, aussi importante, sinon plus : les odeurs. Les maisons jadis, avaient chacune leur odeur, en grande partie selon la cuisine qu’on y faisait. J’ai dit qu’en revenant de l’école, je savais, dès l’entrée dans le corridor, ce qu’on allait manger, car il y avait des odeurs aussi diverses que celles du poisson, des moules, dont j’étais friand, du chou rouge, des navets, du rôti du dimanche clouté de girofle, etc. [...] Je n’irai pas jusqu’à dire que les maisons n’ont plus d’odeurs. Certaines en ont encore, les plus vétustes, celles qui n’ont pas encore, comme à Epalingues, au-dessus d’un immense fourneau, une hotte avec aspiration automatique des vapeurs et des odeurs. Epalingues ne sentait rien. On pouvait y cuire du maquereau sans que, même dans la cuisine, on puisse le deviner.
(Georges Simenon, (72 ans en 1975), “Mes dictées : un banc au soleil”, Presses de la cité, coll. omnibus, Paris, 1993, p. 958.)
Paris - rue Jean-Bologne - vers 1920
Dans les insomnies du petit jour, il m’arrive de refaire cette promenade impossible, et si la fantaisie me prend d’aller, comme autrefois, porter des livres à mon relieur, qui n’habite pas loin de la rue Raynouard, j’hésite entre la rue de l’Annonciation et la rue Jean-Bologne, et presque toujours je choisis cette dernière à cause de son chantier à charbon dont la beauté inhumaine a le charme horrifiant d’un paysage lunaire. Je veux regarder les pyramides noires au fond éclaboussé d’argent, et les stères de bûches à l’architecture babylonienne; il m’est agréable de respirer là l’odeur immémoriale du bois, de l’anthracite et du coke.
(Julien Green, “Paris”, Champ Vallon, coll. Points Essais n°199, Paris, 1983, p. 39.)
Liège - vers 1920
Liège, à cette époque-là, comptait encore un assez grand nombre de ruelles très étroites, aux maisons moyenâgeuses, et le ruisseau des eaux usées, comme on dit à présent, coulait librement au milieu des pavés. L’odeur de ces rues-là était caractéristique et rien que d’y penser elle me revient aux narines.
(Georges Simenon, (70 ans en 1973), “mes dictées : un homme comme un autre”, Presses de la cité, coll. omnibus, Paris, 1993 p. 408.)
Londres - vers 1920
Pourquoi ne pas revoir Londres après des années et avec des regards neufs les musées, le pays et la ville? [...] Je redescendis après trente ans à la gare de Victoria, et je m’étonnai seulement à mon arrivée de ne pas rouler en cab jusqu’à mon hôtel, mais en auto. Le brouillard, le gris tendre et frais, était semblable à celui de jadis. Je n’avais pas encore jeté un coup d’oeil sur la rue, mais mon odorat avait déjà reconnu, après trente ans, cet air singulièrement âpre, dense, humide et qui vous enveloppe de près.
(Stefan Zweig, “Le monde d’hier - souvenirs d’un Européen”, Albin Michel, Paris, 1948, p. 439.)
Pornichet (Loire-Atlantique) – vers 1920
Dès que je débarquais à la gare, l’odorat pour moi s’éveillait là comme nulle part, s’aiguisait en passant et en repassant sans cesse au gré des avenues la ligne de crête qui partageait la petite ville en deux versants d’épaisses senteurs : d’un côté le varech mouillé, de l’autre la résine chaude, - et l’une et l’autre me dilatent encore la narine comme ne le fait aucune odeur.
(Julien Gracq, “Lettrines“, José Corti, Paris, 1967, pp. 167-168.)
Lille – vers 1924
Lille me frappa par sa grisaille, son humidité à goût de métal, sa mauvaise odeur de charbon et d’essence. Il m’était difficile d’admettre, moi qui avais connu la Crimée du Sud et ses jardins, qu’ici tous les arbres de la ville, en dépit de pluies incessantes, fussent couverts d’une épaisse couche de suie.
(Constantin Weriguine, “Souvenirs et parfums“, Plon, Paris, 1965, p. 128.)
Londres, 1924
Quand à la ville de Londres elle-même, elle sent partout l'essence, l'herbe brûlée et le suif, à la différence de Paris où, à ces odeurs, s'ajoutent celle de la poudre de riz, du café et du fromage. A Prague, chaque rue a son parfum à elle: pour cela rien ne vaut Prague.
(Karel Ĉapek, "Lettres d'Angleterre", la Baconnière, Genève, 2017, p.18 [trad. Gustave Aucouturier]).
Paris - la loge de concierge - Paris - vers 1925
Il était rare que je me promène dans les beaux quartiers où cependant je travaillais et j’habitais. C’était la vraie rue qu’il me fallait, avec ses petites vieilles, ses vieillards solitaires, ses commères forte en gueule, ses loges de concierge où régnait une odeur de cuisine mijotée.
(Georges Simenon, (70 ans en 1973), “Mes dictées : un homme comme un autre”, Presses de la cité, coll. omnibus, Paris, 1993, p. 440.)
Paris - rue du Croissant - vers 1925
[des journaux] il y en avait rue Saint-Martin et dans les immeubles de la rue du Croissant consacrés du haut en bas à la chose imprimée.
Je découvrais, des escaliers incroyables, des fenêtres de guingois, des métiers de toutes sortes logés dans ces maisons. Rue du Croissant, c’était l’activité fébrile, la bonne odeur d’encre d’imprimerie, la bousculade sur les paliers et dans les escaliers, car on y imprimait plusieurs quotidiens. [...] je faisais toutes ces courses à pied, le nez en l’air, à m’imprégner de la vie qui coulait autour de moi. Tout me frappait. Tout s’enregistrait, l’apostrophe pittoresque d’un gamin des rues, la dispute entre une marchande des petites charrettes et sa cliente.
De temps en temps, quand j’apercevais un bistrot obscur d’où sortaient des bouffées de vin, j’entrais et buvais soit un saumur, soit un beaujolais, que le patron tirait au tonneau.
(Georges Simenon, (70 ans en 1973), “Mes dictées : un homme comme un autre”, Presses de la cité, coll. omnibus, Paris, 1993, p. 456.)
Sienne – vers 1928
Cette ville entre les villes, Sienne est de toutes, en effet, celle que la nature pénètre le plus. La campagne l’envahit de tous côtés : les vallons finissent en ruelles jusqu’au cœur de la ville : les arbres et les buissons, les oliviers, les cyprès, la vigne et les yeuses ne s’arrêtent qu’au seuil même des portes. Comme de dix lieues à la ronde, dans le val d’Orcia, ou la Crête, ou la Montagnette, on découvre la Tour de la République et le clocher du Dôme, on aperçoit avec bonheur, de cent et cent fenêtres, loges ou terrasses de maisons, les oliveraies et les vergers, les vignes, les figuiers et les branches vertes. Il est des matins où la brise porte à la ville l’odeur du buis ; il y a des midis où Sienne sent la pêche.
(André Suarès, “Le voyage du Condottière. III. Sienne la bien-aimée”, Granit, Le Livre de Poche biblio, n°3259, Paris, 1984, p. 246 (texte paru en 1932). Il faut préciser que Suarès fit, entre 1895 et 1928, 5 voyages en Italie et que les descriptions de villes rassemblent des écrits de diverses époques. Aussi, cet aspect de Sienne est peut-être antérieur à 1928.)
Sienne – Loge du Palais Public - vers 1928
Sur la place du marché, l’air fleurait le poisson de Massa et d’Orbitello, dont les Siennois sont si friands, l’algue et les débris de la marée. L’âcre odeur d’iode montait dans la chaleur.
(André Suarès, “Le voyage du Condottière. III. Sienne la bien-aimée”, Granit, Le Livre de Poche biblio, n°3259, Paris, 1984, p. 474 (texte paru en 1932).
Sienne – Fonte Branda et Contrada dell’Oca – vers 1928
Derrière Fonte Branda, quand je tourne au plus bas de la sente, que je m’engage dans la rue, je peux me pencher sur un brin de menthe, pour ne pas sentir encore l’épouvantable odeur qui vient à ma rencontre : la moindre haleine de vent m’en soufflette le visage. C’est le charnier qui respire et qui pousse son souffle brûlant. Cà et là, les débris de viande pourrie, les morceaux de peaux en putréfaction, toutes les pâtes où le soleil brasse la vermine, travaillent dans les caves, dans les vieux magasins abandonnés, dans les espèces de réduits ténébreux, où l’on entasse les reliefs des tanneries. Les grosses mouches se croisent [...] elles rasent le passant. [...] Ardente et fade, écoeurante et cruelle, la puanteur des tanneurs couvre Fonte Branda et la Contrada dell’Oca. Toutes les maisons sont couronnées de galeries, greniers ouverts à tous les soleils, à tous les vents. Dix arcs, quinze parfois et souvent deux étages de ces loges, l’une sur l’autre : là-dessous, les peaux sont pendues, brunes ou jaunes, grises aussi, livides, au ton lilas fané. Ainsi finissent les grands bœufs blancs, amis du laboureur, si beaux, [...] Ils se vengent par la puanteur de leur dépouille. [...] J’erre dans ce charnier. La senteur astringente du tanin, âpre et vireuse, pique les narines.
(André Suarès, “Le voyage du Condottière. III. Sienne la bien-aimée”, Granit, Le Livre de Poche biblio, n°3259, Paris, 1984, p. 449)
Classe d'école – vers 1930
La classe avait une odeur qui se composait de craie, de transpiration, de vêtements entassés.
(Pierre Sansot, "La France sensible", Champ Vallon, coll. Milieux, Seysel, 1985, p. 196.)
Paris – rue de Belleville – vers 1930
Le long de la rue, les épiceries et les magasins de légumes ne sont plus éclairés que par des lampes d'intérieur. Les commis rentrent les étalages. Les barriques d'anchois salés, avec l'alignement rayonnant de leurs petits poissons métalliques, les grappes de stockedfish, les sacs de riz, de sucre, de fèves, les caisses de pâtes alimentaires. Au bord du trottoir dorment quelques voitures dévastées de marchandes des quatre saisons engluées d'épluchures pendantes, de queues de poireaux, de feuilles de choux, de salades. La rue sent la saumure et le jardin potager, et quelquefois l'épice un parfum aigu et qui bouleverse tout l'équilibre d'un homme et quelquefois le drap, le cuir ou le fer blanc. Il n'y a toujours dans la rue que cette lueur rouge qui sort des boutiques et, de loin en loin les becs de gaz. Devant certains magasins déjà fermés on passe dans une zone d'ombre. Il y a presque toujours à ces endroits là quelqu'un assis sur le trottoir, avec un journal sous les fesses.
(Jean Giono, "Les vraies richesses", Grasset, Paris, 1954, pp. 12-13.)
Bruxelles - Anderlecht vers 1930
Nous gamins, on allait aussi rue Bara. Savez-vous ce qu’on y faisait ? On s’asseyait sur un pas de porte et on restait pendant une demi-heure; et au bout d’une demi-heure, on avait assez mangé de chocolat. On restait là, toute la bande, 7 ou 8 gamins du quartier, rien que pour respirer l’odeur, parce que toute la rue Bara sentait le chocolat à cause de Côte d’Or. On allait s’asseoir sur un pas de porte et : “Snif, snif ... Ah ! C’est bon hein ! C’est bon hein !”
Il faut dire que la rue n’était pas encore polluée par tous les gaz d’échappement. Alors les odeurs, ça se sentait. Parce que j’habitais au 3ème étage, et quand il y avait les marchands des 4 saisons qui arrivaient avec des fleurs printanières par exemple, ils empilaient les fleurs; tout un tas, sur des charrettes et ils traversaient la ville en revendant leurs fleurs; eh bien ! l’odeur des fleurs montait au 3ème étage.
(Antoine Malaise, in: “souvenir d’un vieil Ander-lechtois”: propos recueillis par Frédéric Leroy en juillet 1994, non publié (A. Malaise était alors âgé de 75 ans).)
Bucarest, années 30
Je voulais dire simplement l'impression désespérante que me fit Bucarest dont ma mère m'avait dit que c'était une ville plus belle que Paris, pour me décider à venir. Je me suis promis de ne plus vivre dans cette ville ni dans ce pays. […] Les maisons basses et sales, les rues étroites, l'aspect des gens dans la rue, l'odeur des saucisses que l'on mangeait dans les restaurants en plein air que l'on appelait improprement des jardins d'été …
(Eugène Ionesco, "Un homme en question", Gallimard, Paris, 1979, in : "le goût de Bucarest", Mercure de France, Paris, 2010, p. 15.)
St-Florent (Maine-et-Loire) - place Maubert - vers 1930
Il est un mot qui débouche encore pour moi magiquement, à soixante années de distance, tous les flacons de Baudelaire et qui me restitue même davantage : toute la suavité entêtante d’un jardin de fleurs quand tombe la nuit d’été : c’est un vieux mot, mot local sans doute, que je n’ai plus guère entendu prononcer depuis un demi-siècle : la pavée. La pavée - selon le dictionnaire « mot dialectal désignant la digitale pourprée » -, c’était à Saint-Florent, exclusivement, le tapis compact de pétales effeuillées dont on recouvrait les carrefours et les reposoirs le jour de la fête-Dieu ; des enfants de chœur munis de corbeilles en répandaient un supplément parfumé tout le long du cortège. Il sortait de ce concentré floral prodigué à foison une déflagration odorante qui allait jusqu’à l’ivresse. Mais seule est capable de m’en rouvrir l’accès la sonorité si expressive du mot où passent à la fois la solennité du pavois, la magie sédative du pavot joints à l’idée d’une jonchée profuse et bénigne – où le vocable brutal de « pavé », se féminise, vire à son contraire, et où le v, la consonne la plus fondante de la langue française, libère par surprise toute la suggestion voluptueuse dont elle est grosse. A la prononcer, non seulement je me sens replongé dans ces parfums tournoyants de jardins suspendus, mais je revois presque tout : le reposoir de la place Maubert dans l’éclat de ses housses immaculées – in albis sedens angelus – avec ses candélabres, ses cierges et sa rangée naïve d’aspidistras en pots, les murs des façades de la Grand-Rue tendus partout de draps semés de bouquets et de feuillages épinglés, les longues banderoles rouges à étoiles d’or qui les soudaient l’une à l’autre par-dessus le confluent des ruelles. Ce n’était pas seulement toute la suavité du printemps dans le plein de son explosion qui se trouvait là concentrée, c’était dans sa démesure prodigue, un vrai potlatch de la floraison, qui en épuisait le suc en faveur d’un jour unique de plénitude, et qui l’éteignait d’un coup pour laisser place déjà dans les jardins à toute la poussière, à toute la sécheresse de l’été.
(Julien Gracq, “ Carnets du grand chemin“, José Corti, Paris, 1992, pp. 150-151.)
Bruxelles – Anderlecht – vers 1935
J'habitais rue de la Clinique, rue qui relie la maison communale d'Anderlecht à l'église de Curreghem et traversée en son milieu par la rue Clemenceau. Dans ma rue, il y avait deux chocolateries: Ruelle ainsi qu'un dépôt de Meurice, aux-quelles il faut ajouter l'odeur de la chocolaterie Côte d'Or située rue Bara. Quand les vents venaient du sud-ouest, son odeur se répandait jusque chez nous.
En plus de cela, il y avait l'odeur de houblon des brasseries: trois brasseries étaient implantées dans ce même quartier: Impérial qui avait ses installations de brassage ainsi qu'un dépôt rue de la Clinique et un autre de la firme Cantillon, qui faisait de la gueuze. Ces odeurs allaient de pair avec l'odeur des écuries, parce que ces brasseries avaient des chevaux pour les livraisons: 15 chevaux pour la seule brasserie Impérial par ex. Ces chevaux avaient leurs écuries, soit dans la rue même, soit dans les rues adjacentes. Ces bêtes sortaient sans arrêt, répandaient leur crottin, pissaient en rue par litres ! et les gens venaient ramasser leur crottin pour leurs jardins.
Il faut ajouter à cela les abattoirs qui avaient aussi des odeurs: l'odeur des bêtes, des chevaux, des vaches, de la graisse, l'odeur des paysans,…. Sans oublier les cafés: il y en avaient partout !
(Valéry De Wilde, environ 75 ans, communication personnelle, le 30 octobre 2006)
Paris - La galerie des Beaux-Arts –1938
Exposition internationale du Surréalisme. Dans la salle aménagée par Marcel Duchamp, sorte de grotte à l’obscurité soigneusement étudiée, le plafond est constitué de mille deux cents sacs de charbon suspendus, le sol, jonché de feuilles mortes, comporte une mare de roseaux et nénuphars. Le tout baigne dans une odeur de café du Brésil.
(Boba’No : Françoise, François, Edouard : amateurs d’art, “La peinture en trompe-nez“, in : “Odeurs, essence d’un sens “, Autrement n°92, septembre 1987, p. 203.)
Paris - la loge de concierge – jusqu’en 1940
Jusqu’à la guerre de 1940, [...] Dans ce modèle réduit d’appartement, la loge de la concierge, [...] une odeur un peu écoeurante de ces tanières fermées au jour et aux vues et qui gardaient comme seule senteur celle de la toile cirée de la grande table qui prenait presque toute la place. Au fond, une cafetière bouillante, un poste de radio, les photos. Comme un bric-à-brac. Il y avait aussi à certaines heures de savoureux parfums de nourriture. Nous nous souvenons de notre maison qui, le vendredi, parce que la concierge n’était pas croyante, se remplissait de l’odeur de cuisson des tranches de jambon dont la fumée envahissait la cage d’escalier et venait défier les appartements chrétiens et fidèles aux prescriptions de l’Eglise.
(Jean Cayrol, “ De l’espace humain“, Seuil, paris, 1968, p. 22.)
Paris - les Halles et autour - vers 1940
Naguère à Paris, le franchissement d’un quartier vers un autre, de celui des Halles par exemple à celui des Tanneurs et des Teinturiers, avait accoutumé le passant, le riverain, à l’existence même d’odeurs qui traçaient, en les délimitant, des territoires différents. Au-delà du caractère strictement désagréable et nauséabond qu’elles suscitaient, ces odeurs étaient pour le moins reconnues et partagées par le passant en autant d’espaces porteurs de sens et révélateurs d’une pratique, d’une activité spécifique.
Elles structuraient dans le temps, de manière invisible, l’espace, en suscitant des ambiances particulières. Leur présence signalait au nez et au regard du riverain, un quartier, une rue, avec son fourmillement, ses clameurs et sa tonalité. Seul le nom des rues dans les centres anciens et les faubourgs en Europe en ont gardé parfois la mémoire, presque la saveur.
(Robert Dulau, “Exploration du champ du senti à Pondichéry”, in: “Géographie des odeurs” (sous la dir. de Robert Dulau et Jean-Robert Pitte), l’Harmattan, coll. Géographie et cultures, Paris, 1998, p. 82.)
Lisbonne - Baixa et quartiers de l’est - 1940
La première rue à gauche me mène à la rua dos Bacalhoeiros ou des Marchands-de-morue, le long de bâtiments pauvres qui sentent la saumure et la sciure de bois.
( A. t’Serstevens, "l’itinéraire portugais", Grasset, Paris, 1940, p. 84)
Venise - 1944
Venise, moi je la reconnais à l'odeur. Odeur: esprit de la part mortelle des hommes, des choses, des villes. Ferrare est soeur par l'odeur de Munich. L'une et 'autre sentent la buche brûlée. Villes combien cordiales l'une et l'autre et hivernales. L'une et l'autre invitent à l'espace domestique clos, au gemütlich de la maison. L'eau de Venise a "son" odeur. (de Venise, cette définition d'Amerigo Bartoli: "Venise est une fort noble et vieille dame à la mauvaise haleine".) J'ouvre les narines à l'odeur de Venise, je pense que l'eau aussi a sa vie secrète, que l'eau aussi est une chose mortelle.
(Alberto Savinio, "Ville, j'écoute ton coeur", Gallimard, Paris, 2012, p. 15. [trad. Jean-Noël Schifano])
Rhodes - 1945
La nuit est descendue à travers un brouillard de pluie et dans la gloire d’un arc-en-ciel dont le pied touchait Smyrne. Les paysans disent que lorsque l’on passe sous un caroubier l’arc-en-ciel s’évanouit, et qu’alors le bois exalte un parfum pénétrant et délicieux. Ils mettent des morceaux de ce bois dans leurs armoires pour parfumer leur linge et éloigner les mites.
(Lawrence Durrell, “Vénus et la mer”, Buchet/Chastel, Livre de Poche n°3514, Paris, 1962, p. 52.)
Bruxelles - çà et là - vers 1945
La Senne, lorsqu’elle était à ciel ouvert sentait très mauvais. Cela se remarquait aussi aux quais situés derrière le théâtre Flamand et à côté du boulevard d’Anvers qui se prolongeait sur le site devenu le Bd. Albert II. Cela a duré jusqu’en 1950 environ. L’ancien marché aux poissons, sur ce qui s’appelait les quais, sentait fort également. Les écuries royales ( à côté du Palais des Académies): “ça sentait mauvais”, tout comme celles du déménageur Vander Gooten, où les odeurs se mélangeaient aux fumées du train de marchandises.
(Paul Guerlus, 66 ans, communication personnelle, décembre 1995.)
Bruxelles - çà et là - vers 1945
Cela sentait le chocolat à la gare du Midi et à la place Simonis à cause de la proximité de l’usine Côte d’Or pour la première et de l’usine Victoria pour la seconde; les drogueries: un mélange de cire et de térébenthine et les pompes à essence sur les trottoirs sentaient fort. Le marché aux puces sentait le moisi. Les triperies sentaient plus fort que les boucheries car les étals étaient à ciel ouvert ... Le chemin de fer, les gares sentaient la fumée. Les trottoirs sentaient le savon du fait de l’obligation de les nettoyer à l’eau tous les samedis. Il y avait un bouquet de senteurs des marchés établis sur les places principales (Ste-Catherine, St-Josse, Flagey, etc...). L’Hippodrome de Boitsfort gardait l’odeur des chevaux; à Jette, près de l’hôpital Brugmann, cela sentait les marais et vers Ganshoren, les moissons. Au plateau de Koekelberg, la fermentation de la bière à cause des brasseries, tout comme au fond de Saint-Gilles avec Wielemans. Les garages et ateliers de réparation (nombreux avant 1948) exhalaient une odeur de cambouis. Les imprimeries des journaux (Van Rossel, Le Soir, La Libre Belgique, etc...) le papier fraîchement imprimé et l’encre ; aussi à Saint-Josse, l’imprimerie Le Signe (ou Cygne ?). Les abattoirs de Cureghem sentaient la viande fraîche.
Avant 1940, on pouvait sentir le fer brûlé du rémouleur, le pétrole qui était distribué par une charrette avec réservoir. Et puis, tous les jours, les poubelles (souvent des bacs à ordures) qui étaient versés dans un camion non couvert.
Il y avait aussi l’odeur des Kermesses, Foires, Braderies (croustillons, beignets, pommes d’amour, sueurs, tabacs, bières, escargots, etc... et les pétards brûlés.) Aussi celles des processions avec les pétales jonchant le sol, l’encens, l’antimite des chasubles et étoles, le sable qui saupoudrait les rues.
Avant 1940, le centre ville offrait mille senteurs qui ravivaient le promeneur et l’attirait. Matin, midi ou soir, le flâneur retrouvait des odeurs familières et choisissait selon son désir. La faible circulation des autos, autobus, camions, n’altérait pas la prédominance des senteurs des métiers. Cela sentait le bouillon de mer et de céleri chez les marchands d’escargots. Et chez ceux qui vendaient des châtaignes (marrons), le bois sucré brûlé. Les charcuteries attiraient non seulement par leur choix, mais aussi par l’odeur tentante du fumet des préparations. Par contre, les fromageries répugnaient en exhalant des odeurs fortes de moisi. Les parfumeries prévenaient la clientèle par des senteurs a diverses et alléchantes.
(Léon Crunelle, 71 ans – communication personnelle, janvier 1995.)
Bruxelles - ça et là - vers 1945
Senne: odeur pestilentielle lorsqu’elle n’était pas recouverte : rue du Marché, rue des Palais, chaussée de Gand, ... Odeurs de la Brasserie Aerts à St-Josse .Les impasses sentaient l’urine. Tous les jours on torréfiait le café.
(José Crunelle, 70 ans – communication personnelle, janvier 1995.)
Bruxelles - rue du Progrès - vers 1945
La première rue à gauche dans la rue du Progrès donnait sur la Senne à ciel ouvert, et cela sentait très mauvais, je m’en souviens encore. Au bout de cette même rue du Progrès, se trouvait une fabrique de parfums dont l’odeur d’eau de rose pouvait être perçue jusqu’à la place Liedts.
(Pascuale Gagliazzo 83 ans – communication personnelle, février 1995.)
Uppsala - milieu du XXè siècle
L'odeur des lilas nous accompagne dans la vieille ville en cette fin d'après-midi de juin.
(Julien Green, " Villes (Journal de voyage 1920-1984), Editions de la Différence / Birr, Paris, 1985, p. 216)
Grasse - milieu XXè
Encore jusqu’après la guerre, les rues de Grasse étaient très odorantes. Les industries de la parfumerie installées dans le coeur de la ville utilisant beaucoup d’eau dans leurs traitements, déversaient celle-ci dans les rues. On pouvait ainsi sentir différentes senteurs qui se dégageaient des rigoles longeant les maisons où coulaient les eaux de rinçages chargées d’odeurs d’oranger, de ciste ou de mousse de chêne, etc...
(Thérèse Roudnitska, communication personnelle, février 2001.)
Nantes – paroisse Notre-Dame de Toutes-Joies - années 50
Les processions de la Fête-Dieu font l’objet de grandes mises en scène. Le cortège avec le dais, les cordons, les lanternes. De place en place, un enfant de chœur donne un coup de claquoir, la procession s’arrête, le prêtre qui tient l’ostensoir est engoncé dans une sorte de cape, il présente l’hostie aux fidèles, tandis que les enfants de chœur qui se sont agenouillés agitent leurs encensoirs. D’autres enfants munis de petits paniers jettent des pétales de roses. Les reposoirs (clinique Sourdille, L’hôtel des Bureau, avenue Camus). Les draps décorés de petits bouquets de fleurs tendus le long des façades des maisons dévotes. Le sol des rues jonché de fougères (odeur forte et assez désagréable), plus recherchés : de grands motifs décoratifs en sciure de bois teintée de couleurs vives, réalisés tôt le matin au moyen de grands pochoirs.
(Jean-Pierre Pénault, communication personnelle, juin 2011)
Londres - 1947
Il existe une odeur de Londres, subtil parfum complexe et combiné de brouillard, d’asphalte chaud, de cuir de Russie, de pale ale, de pickles, de tabac anglais (mélangé de miel et d’opium), d’étoffe de tweed.
(André Siegfried, extrait de la conférence donnée le 18 mars 1947 à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris sous le titre “Quelques aspects mal explorés de la géographie: la géographie des couleurs, des odeurs et des sons”, in: “Géographie des odeurs” (sous la dir. de Robert Dulau et Jean-Robert Pitte),l’Harmattan, coll. Géographie et cultures, Paris, 1998, p. 20.)
Amsterdam – Apollolaan – vers 1950
Près de l’hôtel, au long de l’Apollolaan où je me promène après le dîner, des pelouses fraîchement rasées s’étendent jusqu’au bord du canal, ombragées de saules pleureurs, d’ormes, de marronniers et de peupliers ; des pêcheurs s’y installent pour tendre leurs ligne, allongés contre l’eau de tout leur long sur l’herbe. Le quartier, silencieux et cossu, semble être, à lire les plaques des portes, un quartier de médecins spécialistes, une sorte de Harley street. De l’autre côté du canal, au-delà des arbres, de belles et tranquilles maisons de briques, aux façades colonisées par la vigne vierge ; [...] L’odeur stagnante de foin coupé, les grappes jaunes des cytises qui pendent à la verticale dans cette immobilité crépusculaire, aussi inertes que des fils à plomb, enchantent à mesure, au long de ma promenade, ce silence, cette torpeur vespérale d’une grande ville qui semble signifier à tous naïvement, presque ruralement, l’heure rafraîchissante de la couchée.
(Julien Gracq, “ Carnets du grand chemin“, José Corti, Paris, 1992, p. 109.)
Prague - environ 1950
Ce qui me reste de Prague, c’est cette odeur de concombres trempés dans le vinaigre, qu’on vend à tous les coins de rues pour manger sur le pouce, et dont le parfum aigre et piquant réveillait mon angoisse.
(Albert Camus: “La Mort dans l’âme“, in : “L’Envers et l’Endroit”, Paris, 1958, cité par Angelo Maria Ripellino, “Praga Magica, voyage initiatique à Prague “, Plon, Terre Humaine/Pocket, Paris, 1993, p. 234.)
Vérone – 1951
Vérone sent le melon fait. (Jean Giono, “Voyage en Italie“, NRF Gallimard, Paris, 1953, p. 97.)
Venise – 1951
Il [le garçon de café] vient de Modène. Il habita Venise depuis vingt ans. […] Il est Vénitien de cœur. Rien n’est plus beau, dit-il, que d’aller à son aise, un soir d’automne, du théâtre Malibran à San-Marco. La pluie à Venise est un délice. Seuls les étrangers croient au soleil. La pluie réveille l’odeur des maisons. […]
Quand nous avons la pluie des îles grecques, la ville prend son odeur. Dans les chambres, il y a cent ans, on entreposait encore du poivre et de la cannelle. […] Les femmes mettent des clous de girofle dans les coffres à linge. […] Du Palazzo Pisani qui est face de l’Académia, jusqu’à la Mercerai, en passant par le théâtre de la Fenice, on peut aller à couvert d’une maison dans l’autre par des portes secrètes. On brûlait du papier d’Arménie tout le long de ces couloirs. […] La pluie de novembre qui vient de Céphalonie fait sortir l’odeur des murailles. Rien ne donne plus de l’idée qu’une odeur.
(Jean Giono, “Voyage en Italie“, NRF Gallimard, Paris, 1953, pp. 122-127.)
Belgrade – 1953
De la haute ville aux quais de Save, le chemin passe par un flanc de colline couvert de maisons de bois, de palissades vermoulues, de sorbiers, de touffes de lilas. Un coin agreste, doux, peuplé de chèvres à l’attache, de dindons, d’enfants en tablier qui font de silencieuses marelles ou tracent sur le pavé, d’un charbon qui marque mal, des graffitis tremblés, plein d’expérience, comme dessinés par des vieillards. J’y suis souvent venu traîner au coucher du soleil, la tête à rien, le cœur en fête, poussant du pied des trognons de maïs, respirant l’odeur de la ville comme s’il fallait mourir demain. […]
Sur le quai [de la Save], deux hommes nettoyaient d’énorme tonnes qui empestaient le soufre et la lie. L’odeur du melon n’est bien sûr pas la seule qu’on respire à Belgrade. Il y en a d’autres, aussi préoccupantes ; odeurs d’huile lourde et de savon noir, odeurs de choux, odeurs de merde. C’était inévitable ; la ville était comme une blessure qui doit couler et puer pour guérir, et son sang robuste paraissait de taille à cicatriser n’importe quoi. Ce qu’elle pouvait déjà donner comptait plus que ce qui lui manquait encore.
(Nicolas Bouvier, “L’usage du monde“, Payot & Rivages, coll. Petite Bibliothèque Payot, Paris, 2001, p. 51.)
Syracuse, 1954
Peut-être est-ce une imagination, mais il m'a semblé qu'à Syracuse les boulangeries étaient plus nombreuses qu'ailleurs ; partout on est servi par l'odeur du pain frais se mêlant à celles des fleurs garnissant les balcons ou les cours intérieures.
(Guido Piovene, "Voyage en Italie ", Flammarion, Paris, 1958, p. 449.)
Epidaure - 1955
… une question de sensibilité ou d’approche personnelle. Eschyle, c’est vrai, sera toujours lié pour moi aux cris, aux lumières, aux odeurs et aux bruits d’Epidaure (et je me souviens qu’après la seconde représentation des Perses, en 1955, quand je jouais Xercès, je suis resté assez longtemps sur le théâtre après le départ des derniers spectateurs et que toutes les senteurs de la terre ont jailli brusquement comme si la nuit montante les libérait, mêlées aux odeurs des pierres et des gradins chauffés par le soleil de la journée – rugueux et tièdes sous la main. Quand nous sommes descendus avec le car vers le vieil village d’Epidaure où nous devions passer la nuit, le vent apporta sans cesse des bouffées de ces senteurs champêtres – foin séché, résine, térébinthe – et cela fut si fort, si intense que je me demandai si les théâtres antiques avaient aussi ces odeurs-là, si elles étaient celles d’un théâtre vivant ou si elles étaient liées aujourd’hui à l’abandon et au silence de ce théâtre mort), mais tous ces bruits et odeurs ne sont qu’émotions, souvenirs subjectifs.
(Jacques Lacarrière, “L’été grec, une Grèce quotidienne de 4000 ans“, Plon, coll. Terres humaines, Paris, 1975, p. 164.)
Prague - 1956
Et je puis bien le dire maintenant, ce qui me reste de Prague, c'est cette odeur de concombres trempés dans le vinaigre, qu'on vend à tous les coins de rues pour manger sur le pouce, et dont le parfum aigre et piquant réveillait mon angoisse et l'étouffait dès que j'avais dépassé le seuil de mon hôtel.
(Albert Camus, "L'envers et l'endroit" (1956), in: Oeuvres complètes, Quarto Gallimard, Paris, 2013, p. 121)
Bruges - vers 1960
Ici, à Bruges, j’ai pensé à toi Prague. Le long des canaux putrides et somnolents, sur les pelouses où se pressent des groupes de cygnes blancs avec un B sur le bec, devant le Markt qui évoque la défunte splendeur des Flandres, face aux maisons-Dieu, rue de l’Ane aveugle, quai du Miroir, dans les boutiques où s’entassent candélabres, broderies et bagatelles en cuivre, j’ai pensé à toi, Prague, à tes splendeurs de pierre et à tes coffres emplis de débris rouillés, à tes concombres au vinaigre dont l’âcre senteur provoque l’angoisse. La pourriture des eaux fétides de Bruges a une étroite parenté avec la moisissure de certaines de tes ruelles dans la petite île de Kampa.
(Angelo Maria Ripellino, “Praga Magica, voyage initiatique à Prague “, Plon, Terre Humaine/Pocket, Paris, 1993, p. 234.)
Athènes – 1960 quartier à côté de l’église Sante-Irène
Brûler les plus purs encens, chez soi, devant l’icône familiale ou le soir, devant la porte de la demeure, pour chasser les démons, est une des manifestations les plus constantes de la piété grecque. Des marchands ambulants en vendent, un peu partout, dans les rues, les variétés les plus précieuses et les plus délicieusement odorantes, qui n’ont rien de commun avec les fades résines de nos églises. […] Deux marchands ont leur étal de plein air sur le marché aux plantes, à côté de l’église Sainte-Irène. Bien que ces encens soient coûteux, les acheteurs sont nombreux, des femmes surtout. Cela se pèse au gramme sur une balance de pharmacie, avec de très petites et très minces lamelles de cuivre. Pour attirer la clientèle, lui et son confrère d’en face se font constamment brûler de menus fragments sur un tison de charbon de bois. Malgré l’intense trafic motorisé de la rue Eole, et les relents de cuir neuf qui sortent des innombrables boutiques de chaussures, la petite place aux plantes et la rue, jusque très loin, sont toujours remplies d’une suave senteur religieuse.
(A. t’Serstevens, "Itinéraires de la Grèce continentale", Arthaud, paris, 1961, pp. 42-43.)
Bruges – vers 1960
De mauvaises odeurs peuvent nous rappeler de bons souvenirs sans pour cela qu’on veuille nécessairement les retrouver.
Bruges avant le nettoyage des canaux sentait très mauvais en été. Certaines régions autour de Gand sentaient très mauvais - l’usine Fabelta - bien que cela puisse évoquer un très bon contexte. Ce sont des situations très valorisées affectivement et que l’on remémore, c’est évocateur de contextes, mais moins précis que la vue.
(Geneviève Declève, 66 ans, communication personnelle, février 1996.)
Paris – Les Halles – vers 1960
Là où l’auteur de “ L’assassinat de Paris “ Louis Chevalier, n’a peut-être pas tort, c’est quand il voit dans le “ trou des Halles “ l’évulsion du cœur secret de la capitale. Cœur certes plein d’ordure, mais d’où montait sur la ville aux heures avancées de la nuit un fumet de canaillerie lourde et sanguine, qui était de toutes les essences de son parfum composite l’odeur la plus originale. Odeur intime d’une ville grossie autour d’un peloton inextricable de boyaux fermentants, ayant pour noyau moyenâgeux ses rues de boucheries et de triperies d’où l’émeute à chaque instant s’échappait, les bras rouges de sang avant même de commencer.
(Julien Gracq, “ Carnets du grand chemin“, José Corti, Paris, 1992, p. 115.)
Séville – vers 1960
Séville n’est pas blanche – je veux dire blanche partout. Mais, partout, Séville est parfumée. D’où certaine ivresse que l’on puise en elle par le nez. A quelque niveau qu’on le porte dans l’air, on y décèle une odeur.
Et d’abord l’odeur fondamentale, le soubassement, à ras du sol. Baissez-vous pour relacer votre soulier. Dans certaines rues étroites, qui affluent aux Sierpes, dans Sierpes même, c’est fondamentalement, dis-je, une odeur deux fois basse : l’odeur fécale qui monte des pays tropicaux. (Me même un goût d’essence est au fond du pain.) Odeur solaire.
Cette odeur fondamentale se décompose de-ci de-là en odeurs sèches, odeurs de brûlé, de sac de corde, de café aigre, odeurs suries. Enfin, à hauteur de tête, cette gamme obscène se résorbe dans la nappe divine et suprême de la fleur d’oranger dont la ville entière est submergée (au mois d’avril, tandis qu’en juillet, c’est l’odeur de jacinthe, à tituber).
Ville entêtante, capiteuse : on la sent d’heure en heure qui vous monte à la tête. Ville aphrodisiaque. Ces parfums nobles fluent des lacs odorants que sont les jardins de l’Alcázar, merveille d’exubérance et d’ordonnance végétales, puis la Cour des Orangers, au pied de la cathédrale, puis les grands parcs, feux d’artifice de palmiers : Maria-Luisa.
Le parfum coule alors par les ruelles, stagnant aux petites places inondées de fraîcheur, mosaïquées, céramiquées, pleines d’ombre et de sonorité, où s’assemblent les philatélistes, où les familles vivent sur le pas des portes, au frais, où il arrive que danse une gitane ou un ours, ou les deux, pour quelques sous.
(Paul Werrie, "La Fête andalouse", Mercure de France, Paris, 1972) (in : guide Gallimard, Séville)
Paris – vers 1965
C’est un peu avant l’aube, en décembre et par temps couvert, que l’odeur de Paris se révèle tout à fait ; âcre, sulfureuse, elle oblige à ne respirer qu’à petits coups et fait tousser. Nuée fétide, refusée par le ciel et qui s’étale horizontalement sur la ville et la baigne, amalgame condensé des fumées des calorifères et des exhalaisons méphitiques aux relents d’œufs pourri des usines de banlieue, rabattues sur les maisons, auquel s’unissent le rance rappel des nourritures avariées et les fades remugles qui montent des égouts, des caves et des cimetières.
(Jacques Brosse, “Inventaire des sens“, Bernard Grasset, Paris, 1965, p. 23.)
Paris – avenue Wagram – vers 1965
Il fut un temps où les odeurs de Bing étaient célèbres ! Nous avions toujours 100 à 200 kilos d’ambre … L’été, on nous sentait du haut en bas de l’avenue Wagram ! Moi, mes vêtements continuent à sentir, les chiens me sentent, même après des années. Autrefois, mes amis me disaient que j’empestais !
(Jacques Schlienger (négociant de matières premières animales – ambre, musc, civette et le castroréum – pour la société Bing), interviewé par Jacqueline Blanc-Mouchet in: “Odeurs, essence d’un sens “, Autrement n°92, septembre 1987, p. 166.)
Ajaccio – vers 1967
L’odeur du maquis vient au devant de vous au large du port d’Ajaccio et ne vous quitte plus : en rouvrant au retour ma valise, je la retrouve sur mes vêtements enfermés. C’est une odeur sèche, chaude, résineuse, mais sur cette ex-halaison de pinède surchauffée s’exhalent des essences plus délicates : tantôt sucrées et presque mielleuses, à la manière du sureau ou du seringa, tantôt épicées et presque sacramentelles, comme s’il y brûlait par moments un grain d’encens : l’impression de sécheresse pince les narines, en même temps qu’elle les réjouit, comme si tout ce qu’on respire venait d’être vaporisé sur une pelle rougie au feu : ce sont déjà les parfums de l’Arabie Pétrée, non les molles odeurs défaites qui coulent de nos forêts de brouillard. Auprès de l’odeur des forêts landaises que pourtant j’aimais déjà, c’est comme si on libérait les éthers subtils d’un grand bourgogne après avoir débouché une bouteille d’aramon.
(Julien Gracq, “Lettrines“, José Corti, Paris, 1967, pp. 60-61.)
Sète – vers 1970
La gare de Sète, c'est le meilleur point d'arrivée dans ce bas-Languedoc. […] . Tout de suite, vous sentirez l'odeur du sel, de la rouille, de l'eau et, si le sable avait une odeur, ce serait celle-là, l'odeur de Sète.
(Pierre Sansot, "La France sensible", Champ Vallon, coll. Milieux, Seysel, 1985, p. 119.)
Berlin – gare du Zoogarten – vers 1970
La vieille gare du Zoogarten est l’un des endroits les plus fascinants de Berlin. On y côtoie, jour et nuit, des êtres étranges que l’on ne peut oublier. L’aspect triste et sale de la gare contraste violemment avec le Kurfürstendamm et la richesse des rues qui l’entourent. A une centaine de mètres du quartier le plus luxueux de Berlin, elle se dresse auréolée de ses odeurs aigres de bière et de saucisses, avec ses vagabonds et ses mendiants.
(Jean-Michel Palmier, “Retour à Berlin“, Petite Bibliothèque Payot/Voyageurs, Paris, 1997, p. 23.)
Hambourg – XXè siècle.
Dans la lumière bleutée de l'aube, le marché aux poissons est l'endroit le plus couru de Hambourg. Il faut y être à quatre heures du matin. Les odeurs de la mer sont si fortes qu'elles semblent être devenues elles-mêmes les couleurs des poissons.
(Julien Green, "Villes (journal de voyage 1920-1984)", Le Seuil, La Différence, Paris, 1985, p. 86)
Rome – 1975
Des débris d’antiques, des jardins odorants, des parcs où se pressent par buissons entiers lauriers roses et blancs, un moutonnement de coupoles et de frontons, des quartiers récents, découpés nets; les rumeurs d’une ville participant de la fièvre moderne, composent à Rome un espace orchestral où chaque aspect fait geste et prend valeur de signe.
(Edmond Radar, “Carnets romains“, in : Questions 2, Publication de l’Institut Supérieur d’Architecture Saint-Luc, Bruxelles, Printemps 1982, p. 39.)
Venise – 1978
L'arrivée par avion. Dès qu'on a mis le pied sur le tarmac, le corps est baigné par cet air tiède et humide dont les composés de musc, de vase et d'anis soufflent au visiteur le nom du lieu où il est arrivé. La griffe VENEZIA s'inscrit en lettres bleues sur les murs de l'aéroport, comme sur un vieux flacon décoré au plomb.
Un parfum est promesse et déception. La narine retourne indéfiniment au calice, à l'aisselle, à la bouffée du vent, humant une question à laquelle l'esprit ne sait répondre. C'est dans l'espoir d'en déchiffrer l'énigme qu'on revient à Venise. Que dit un parfum? Il répète, il insiste, il trame, il susurre, il s'évapore, il revient, il est remugle autant qu'exhalaison, il refuse à se laisser saisir, il est accomplissement et dérobade.
[…] Comme je comprends ces Vénitiens qui, ayant la chance d'avoir un jardin, protègent soigneusement le secret qu'il contient en l'enserrant derrières de hautes murailles. Gardées par les statues de Pomone et de Mercure, elles ne sont franchies, le soir venu, que par les chats, amoureux des odeurs. La nuit, quand je longe ces murs de brique, gonflés par endroits sous la poussée des buissons qu'ils enclosent, j'aspire à n'en plus finir le parfum de jasmin et de tubéreuse qui en sourd. Tant de suavité, à défaut d'un vrai paradis, prépare à un sommeil serein.
Tous ces fumets de poisson frit qui flottent dans les cali sur le coup de midi. Odeurs grasses des daurades alla griglia, saveur acide des seiches ai ferri, fumet des moules à la vapeur, parfum aillé des queues de lotte, bouquet piquant et frais des mollusques: on s'imagine ainsi le paradis d'Allah des félidés. Baignés dans ces odeurs, les chats de Venise s'endorment gavés.
(Jean Clair, "Le voyageur égoïste", Payot & Rivage, Petite Bibliothèque Payot / Voyageurs, Paris, 1999, pp. 220, 232 & 233)
Berlin – vers 1980
Le vent amène de l’Est de la ville une odeur de charbon et de fumée d’usine. Il s’y mêle le parfum plus âcre de ces briquettes de lignite qu’on enfourne, enveloppées de papier journal, dans les vieux poêles de faïence. Au gré des rues, il se métamorphose. Un souffle d’air apporte au printemps l’odeur sucrée des fleurs de robiniers. A l’automne celle des feuilles mortes. De la Spree émanent des senteurs d’eau croupissante. A Dahlem l’air est parfumé par l’odeur des sapins et des forêts toutes proches. Wedding, Kreutzberg sentent la pauvreté et la fumée, avec les usines et les détritus des arrière-cours. Le moindre porche, les vieux escaliers ont une odeur de cave et d’humidité. Que dire du parfum des vieux livres dans ces librairies obscures, de la cannelle et des clous de girofle qu’on ajoute au vin chaud vendus au coin des rues, du curry qui entoure les Schnell-Imbiss ? Et cette odeur de soupe aux pois et au lard qui émane de l’assiette fumante où l’on immerge une tartine de pain noir et qui vous enveloppe en passant devant les restaurants ouvriers de Wedding, ne symbolise-t-elle pas, mieux que toutes les autres, les multiples parfums de ces rues de Berlin ?
(Jean-Michel Palmier, “Retour à Berlin“, Petite Bibliothèque Payot/Voyageurs, Paris, 1997, p. 248.)
Venise – vers 1985
Dès l’arrivée, dès les premiers pas au sortir de la gare, on est saisi par l’odeur de mer, fouetté par le vent: en une minute le dépaysement tonifie le voyageur.
(Claude Dourguin, "La lumière des villes", Champ Vallon, Seyssel, 1990, p. 97)
Salzbourg – 1988
Fonctionnels, la plupart des aéroports ont perdu toute odeur. Construits pour distribuer les corps dans l'espace, ils ont la senteur uniforme et fade des machines. Mais il demeure en Europe quelques lieux qui ont gardé avec la nature des liens assez puissants pour qu'on les rebaptise du nom d'aérodromes. Il y a Venise. Il y a Salzbourg. En ce lieu, au sortir de l'avion, il y a toujours cette vague de fumier frais et de luzerne coupée qui dévale des montagnes pour accueillir le voyageur surpris. Certains soirs d'été, lorsque vient l'orage, l'odeur se fait si forte qu'on titube sous son ivresse. […]
Toute la ville sent le foin et le crottin de cheval, parmi ses enveloppements de pistache et de rose.
(Jean Clair, "Le voyageur égoïste", Payot & Rivage, Petite Bibliothèque Payot / Voyageurs, Paris, 1999, pp. 262 & 264)
Venise – vers 1990
Il n’y a que Venise, peut-être, pour exhaler à des kilomètres à la ronde cette vapeur d’eau saumâtre si particulière.
(Nathalie Poiret : “Variations sur les paysages olfactifs“, in : Ambiances architecturales et urbaines, Les cahiers de la recherche architecturale, n°42/43, 3ème trimestre 1998, Editions Parenthèses, Marseille, p. 188.)
Bruxelles - Buizinghen - 1993
Installée au coeur de Buizinhen, quartier résidentiel de la banlieue bruxelloise, la fabrique de gaufres Suzy se découvre d’abord par le nez. Il y flotte un parfum caractéristique de sucre vanillé mêlé aux effluves reconnaissables de la pâte à grand-mère.
(Marc Vanesse, in: Eco-Soir, journal “Le Soir”, 24 sept 1993, p. 8.)
Bruxelles - çà et là - 1994
... Tu me reproches le fait d’avoir écrit que la ville ne sentait pas beaucoup, pourtant, les personnes arrivant de la campagne disent que la ville (Bruxelles) sent la pollution.
Je vais préciser mon point de vue:
en haut de la ville, occasionnellement, cela sent le goudron lorsqu’on pose de l’asphalte sur la chaussée, et quelquefois, juste après la pluie, l’humus dans les parcs. Très ponctuellement, une porte peinte à l’huile révèle un travail récent et les solvants d’autres peintures ou colles émettent plus largement leurs odeurs caractéristiques. Longeant certaines vitrines, des relents de tétrachlorures annoncent une boutique de nettoyage à sec, et passant devant la porte ouverte d’une wassorette: ce sera un mélange d’odeur chaude et de savon. A d’autres endroits, l’haleine de pain chaud sortant du soupirail de quelques boulangeries se découvre quelquefois, mais rien de comparable à ce qu’on rencontre en France. La piscine Longchamp à Uccle sent le chlore déjà une bonne dizaine de pas avant les portes d’accès.
Par contre, lorsqu’on descend dans le centre ville, les choses changent. Tout comme les accents de la langue sont plus prononcés dans les quartiers populaires, les odeurs y sont également plus présentes et plus nombreuses. Au-tours de l’église Ste-Catherine: ce sont fritures et l’odeur de sucre chaud des marchands de gaufres, mais aussi de caricoles et en automne, de marrons chauds. Les poissonneries sentent plus que d’habitude, se “répandent” plus largement sur les trottoirs et le matin, dans les cafés, l’odeur de fumée de tabac refroidie y est forte et plus marquée qu’ailleurs. Toutes choses variant au cours des saisons: les ruelles humides où le soleil n’entre jamais sentent l’urine de chat au printemps mais deviennent inodores les jours pluvieux de novembre. Entrant dans l’église, les senteurs lourdes des restants d’encens ne sont pas les mêmes lorsque, dans la nef il fait doux ou, au contraire, froid et cru par temps d’hivers.
Au marché de la place, c’est l’odeur des fraises qui m’a toujours semblé de détacher des autres, s’annonçant d’elle-même à l’avance entre les étals.
Tu me dis que des odeurs nouvelles remplacent les anciennes : certaines stations de métro ont cette odeur de graisse que l’on retrouve chez les garagistes, mais les repères anciens qu’étaient pour moi l’odeur de chocolat de l’usine Côte d’Or au sortir de la gare du Midi, du mélange d’éther et d’alcool camphré des hôpitaux ou l’odeur sûre du lait battu que l’on pouvait découvrir à l’échoppe du laitier au marché, ont disparu à jamais. Certaines personnes trouvent que les pharmacies avaient des odeurs tenaces d’iode, j’ai le souvenir que les cinémas sentaient la poussière. Je me souviens fort bien de l’odeur (la puanteur) des âcres relents venant de l’entreprise Jacqmotte lorsqu’ils torréfiaient le café (les lundis ?), odeur apportée par les vents du Sud-ouest, odeur qui enveloppait tout (et qui, contrairement à moi, enchantait mon voisin de Vaucresson), et aussi de l’odeur du houblon se dégageant des brasseries.
Je garde mon sentiment que la ville ne sent plus beaucoup ...
(Marc Crunelle, lettre à Geneviève Declève)
Pienza - Toscane - vers 1995
Dès que l’on rentre, tout le village sent le Pecorino: c’est un fromage comme le parmesan.
(S. J., Libraire, 45 ans, 2000, communication personnelle)
Brest – vers 1995
L’odeur du soja, quand souffle le surcroît sur Brest, les effluves caractéristiques du lisier, très fréquent dans le Finistère et en Bretagne, sont perçus, inévitablement, par quiconque réside ou passe quelques jours dans la ville et sa région . […]
Les odeurs de la ville : ce sont celles, d’abord, inhérente au site. Brest est une ville de bord de rade et vers le fond, au débouché de l’Elorn, on signale, selon la marée, des relents de vase. C’est aussi le cas sur les bords de la Penfeld, à cause de la marée, mais aussi par la présence d’eaux plus stagnantes. […]
Il reste l’usine de trituration du soja (Soja-France du Groupe Cargill) et c’est au-jourd’hui la principale source d’odeurs sur la ville. Le soja, provenant essentiellement des Etats-Unis, d’Argentine et du Brésil, est déchargé et transféré directement du bateau dans des silos. Lors de cette opération, des graines, s’échappent constituant la “ freinte “ (terme de la marine marchande désignant les pertes au moment du déchargement de marchandise). Les graines perdues et dispersées autour de l’usine s’imprègnent d’humidité, fermentent et dégagent une odeur caractéristique plus ou moins tenace. L’odeur peut provenir aussi du séchage des graines avant traitement. Le taux d’humidité ne peut être supérieur à 12%. La vapeur d’eau dégagée est imprégnée du “parfum “ du soja. Les vents du Sud ou du Sud-Ouest selon leur force la répandent sur une partie de la ville. Les quartiers jouxtant le port la subissent le plus souvent et de façon intense et les riverains s’en plaignent fortement. En s’éloignant vers le centre-ville et jusque vers les quartiers plus au Nord ou Nord-Est (Lambézellec, Kergaradec), on sent épisodiquement “le soja“, sans que cela apparaisse comme une gêne. De temps en temps et en petites quantités, le port de Brest importe du manioc lequel génère des relents très forts, plus désagréables que le soja. On le signale moins et c’est un fait acquis : quand souffle le surcroît, “ Ca sent le soja “.
Ainsi, la ville porte-t-elle une “étiquette olfactive “ : odeur locale certes, mais qui témoigne de l’intégration de Brest, dans un espace très vaste, mondial même depuis les Amériques jusqu’au Sud-est asiatique : c’est l’avant-pays d’un port qui reçoit et traite des produits destinés à l’alimentation animale. Au sortir de l’usine, la farine de soja est distribuée dans un arrière-pays restreint aux limites du Finistère. (Nicole Mainet-Delair, “Fragrances, fumets et pestilences. Etat des lieux en pays brestois“, in: “Géographie des odeurs “
(sous la dir. de Robert Dulau et Jean-Robert Pitte), l’Harmattan, coll. Géographie et cultures, Paris, 1998, pp. 221, 225 et 227.)
Maisons-Alfort - 1995
Depuis plus d’un siècle, l’odeur fétide de la fermentation marque l’espace et le rythme le temps des Maisonnais. L’usine Springer, qui fabrique de la levure, (15 ha d’usine en plein centre ville), produit des odeurs qui marquent de leur empreinte fluctuante et impalpable l’ensemble d’un territoire urbain. Quand on les interroge à propos de l’odeur, les gens ont souvent du mal à décrire autrement que par une réaction de rejet: “c’est extrêmement désagréable”, “c’est à vomir”, ‘c’est une horreur, épouvantable”, “ça a un côté douceâtre, écoeurant”. Les équarrissages de chevaux qui étaient encore pratiqués jusqu’à une date récente à l’Ecole Vétérinaire représentaient la deuxième nuisance olfactive dont souffraient les Maisonnais. (Vincent Moriniaux, “Les odeurs de levure dans la ville de Maisons-Alfort “, in: “Géographie des odeurs “
(sous la dir. de Robert Dulau et Jean-Robert Pitte), l’Harmattan, coll. Géographie et cultures, Paris, 1998, pp. 159-161.(précisons que l’usine “Fould-Springer possède le leadership mondial dans le domaine des protéines de levure qui servent à aromatiser les bouillons, les potages et les plats cuisinés. Mais c’est surtout 15 ha d’usine en plein centre ville, 5 fermenteurs de 300 m³, 8 bacs de stockage des crèmes de levure et une odeur pestilentielle qui se répand sur la ville, aux abords directs de l’usine et dans certains quartiers”, idem p. 159.)
La Rochelle – 1995
A La Rochelle, en l’occurrence, le Rochelais ne sent plus la mer, l’iode ou d’autres odeurs marines. Ce n’est que par grand vent, pluie, ou grandes marées que les effluves parviennent jusqu’à ses naseaux lésés, atrophiés qu’ils sont par trop de familiarité avec les embruns. […]
L’arrivée à La Rochelle depuis Poitiers ou Paris par le train et l’esplanade de la gare ne mettent pas le voyageur en contact visuel avec la mer. Pourtant, il n’est pas rare d’entendre nombre de réflexions sur les odeurs océanes : “Ca sent la mer, l’iode, le poisson “. […]
La Rochelle est une ville moyenne (déchets) et une modeste ville industrielle. Les quartiers de Port-Neuf et de La Pallice concentrent plusieurs grosses infrastructures. Deux posent de sérieux problèmes au voisinage de par leurs odeurs : la station d’épuration à Port-Neuf et l’usine Rhône-Poulenc à La Pallice. Les problèmes sont récurrents depuis des années et les odeurs rebutantes.
L’usine d’engrais Angibeau/Gratecap dans le quartier de Bongraine. C’est l’élément phare de cette géographie rochelaise des odeurs. A elles seules, les aires de stockage de cette usine d’engrais sont capables de perturber les conditions de vie de nombreux habitants de la préfecture de la Charente-Maritime. L’usine est isolée entre d’anciens marais-salants et les voies de chemin de fer et les premiers quartiers h’habitation sont à 500 mètres. Pourtant, l’aire odoriférante de l’usine peut atteindre la quasi-totalité de la ville de La Rochelle quand le vent vient du Sud, Sud-Sud-Est. Les mauvaises odeurs sont fréquentes dans un rayon d’un kilomètre (8 à 10 fois par mois selon les saisons et les conditions météoroloiques). Le centre ville est touché annuellement dans des proportions similaires (une dizaine de fois), mais l’odeur est si particulière qu’elle marque les esprits. On sent que ça sent. Le quartier de Tasdon, proche de l’usine, subit les désagréments les plus importants.
(Louis Marrou, Philippe Guerry, Michèle Jean-Bart, Fabrice Lartigou, “Pour une géographie des odeurs à La Rochelle“, in: “Géographie des odeurs “ (sous la dir. de Robert Dulau et Jean-Robert Pitte), l’Harmattan, coll. Géographie et cultures, Paris, 1998, pp. 237 et 246.)
Florence
L'atmosphère d'I Tatti (maison de Bernard Berenson au nord de Florence) était parfumée d'herbes rares, exhalant une fragrance proche du patchouli, que Berenson faisait venir d'une obscure région de Russie.
(Federico Zeri, "J'avoue m'être trompé", Gallimard Folio n°3779, Paris, 1995, p. 44.)
Virton (Belgique) - 1996
A Virton (Sud de la Belgique, après Arlon), nous savons que nous nous approchons du centre parce que l’odeur prononcée de choux, provenant de l’usine de pâte à papier voisine s’accentue. Dès qu’il pleut, toute la région sent le choux, je ne sais pour quelle raison c’est plus prononcé à ces moments-là. Ca sent plus fort dans les cuvettes. Il y a des gens que ça dérange, moi pas.
Les gens étaient contents de retrouver l’odeur quand l’usine a rouvert après 3 années de fermeture. (l’usine emploie environ 1500 personnes)
[Source principale des odeurs: juste après cuisson qui se fait avec une solution de soude caustique et de sulfure sodium, on vide les autoclaves produisant un dégagement d’H2S, composés organiques sulfurés qui sont odoriférants à faible dose.]
(Sophie Duquet, 22 ans, (étudiante de 5ème année à l’institut Supérieur d’Architecture Victor Horta, Bruxelles, février 1996.))
Lorsqu’on traverse cette région, on dirait que tout le monde cuit de la choucroute. (Chantal Cornil, c en ommunication personnelle,1996)
Nîmes - 1996
Quand on roule en voiture sur l’autoroute, pendant toute la route on a les vitres fermées, quand j’arrive à Nîmes au péage et que j’ouvre les vitres, là il y a une odeur de garrigue qui ressort et qui est vraiment typique ... à Nîmes et à sa région. ... Bon alors c’est surprenant parce que Nîmes c’est quand même ... la garrigue ne se trouve pas ... à côté du péage d’autoroute, mais cette odeur dégage ... ça dégage le midi, les cigales, la garrigue, (...) c’est surprenant quoi. Et je n’en aperçois dès que j’ouvre ma vitre au péage de Nîmes quoi. (...) là on reconnaît où on est, y’a pas de problème.
(Y, in Suzel Balez, "Les ambiances olfactives dans l'environnement construit", Tome II: corps d'anecdotes, p. 81, DEA Ambiances architecturales et urbaines, CRESSON, Grenoble, 1996.)
Oulu – (Finlande) - 1998
Durant tout mon séjour au mois de mars, cela sentait le suret dans toute la ville. Les usines de pâte à papier répandaient cette odeur constamment présente.
(Marc Crunelle)
Séville - jardin de l’Alcazar - 1998
Séparé des grands axes de circulation par de hautes fortifications, le jardin du palais royal présente une disposition en forme de croix d’origine almohade, faisant référence aux quatre fleuves de la vie qui coulent dans le jardin du paradis. Une pénétrante odeur de buis souligne les allées: les cyprès et les stipes des palmiers rythment l’espace; les fines branches des orangers et des citronniers ombragent les parterres fleuris. Les nuits d’avril, leurs fleurs largement dilatées exultent leur azahar (fleur d’oranger) envoûtant, l’amertume des conifères s’estompent, les tubéreuses enivrent. L’hiver, dominent les parfums capiteux de jasmins et le fumet des acacias. Plus tard, au printemps, les sucs des rosiers se mêlent aux forts arômes de chèvrefeuille et de genêts, de menthe et de mirabelles, aux odeurs entêtantes des lys et des narcisses. Plus tard encore, dans les nuits chaudes de l’été les dames de nuit triomphent, odeur violente d’héliotrope, aux effluves vanillés. Au hasard des parterres, émane le poivre des oeillets. Dans l’atmosphère quelque peu rafraîchie de l’automne, fleurissent les néfliers du Japon dont les fragrances se mêlent aux parfums délicats des armoises, mélisses et verveines. Au-delà des jardins de l’alcazar, plus vaste, plus ombragé, le parc Maria Luisa, offre à un plus grand public ses essences méditerranéennes et tropicales.
(Sophie Lignon-Darmaillac, “L’Alcazar et l’encens, géographie des odeurs sévillanes”, in: “Géographie des odeurs” (sous la dir. de Robert Dulau et Jean-Robert Pitte), l’Harmattan, coll. Géographie et cultures, Paris, 1998, p. 213.)
Trieste – 1998
Le golfe est large et découpé, le rivage ourlé de nombreux pins odorants, végétation qui résiste au bora et au gel.
(Predrag Matvejevitch, "Gênes, Trieste, Rimini", in: Bertrand Lévy & Claude Raffestin (dir.), "Voyage en ville d'Europe", Ed. Metropolis, Genève, 2005, pp. 224-225)
Lisbonne – vers 1999
Il y a aussi des voix, des odeurs à reconnaître – des odeurs, et quelles odeurs: sans aller plus loin, celle du poisson salé en tonneau dans les boutiques de la Rua do Arsenal; celle de la mer à certaines heures dans les docks du Tage; celle de l'été nocturne des parterres de Lapa; des dépôts d'articles de marine entre Santos et Cais do Sodré; et encore celle du poisson en train de griller sur les braseros à la porte des gargotes, dans les encoignures et les ruelles, depuis le Bairro Alto jusqu'à Carnide.
(José Cardoso Pires, "Lisbonne, Livre de bord", Gallimard, coll. Arcades, Paris, 1998, p.14).